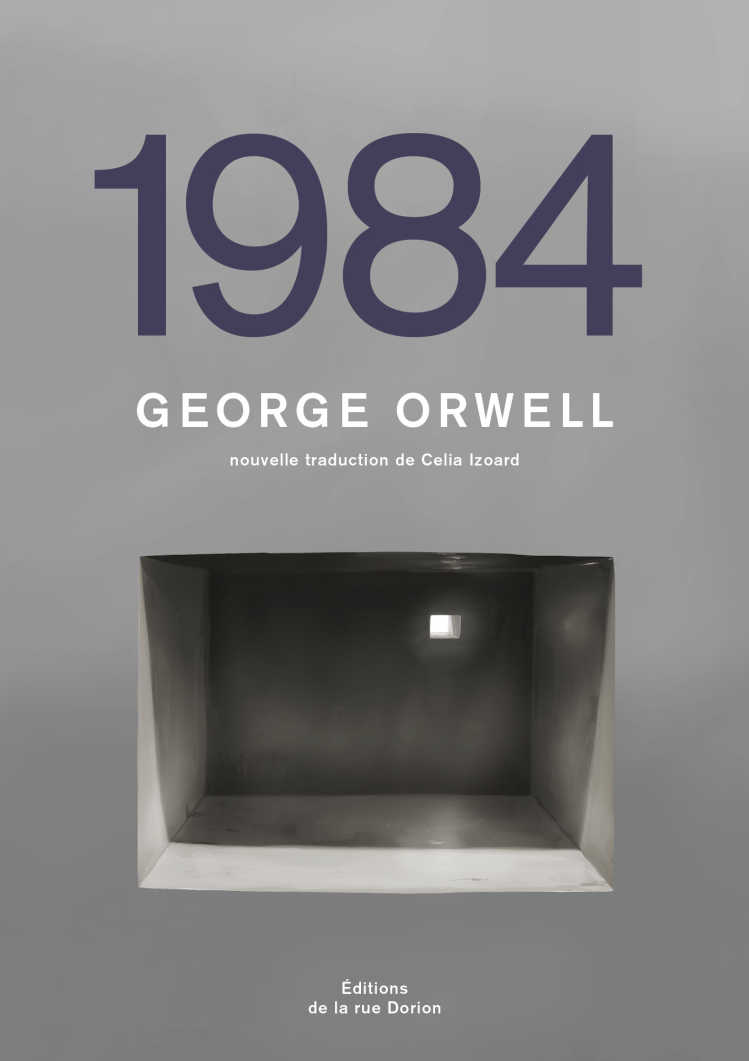On retrouve aujourd’hui une panoplie de publications critiques sur le progrès technologique. Ce qui distingue l’ouvrage de David Noble est son propos résolument engagé et une analyse de classe de la technologie s’inscrivant dans le champ de l’histoire sociale expliquant comment l’automatisation a contribué à la déqualification, à la précarisation, à la délocalisation, à la sous-traitance, bref, à la dépossession des travailleurs et des travailleuses. Dans ce recueil d’articles écrits dans les années 1980 mais toujours actuels, l’historien des sciences et techniques ne vient pas seulement déconstruire l’idéologie du progrès qui était censé multiplier nos capacités d’action : il nous convie à la résistance devant cette « dégradation systématique de l’humanité au rang de supports temporaires de production et d’accumulation » (p. 14).
Le caractère hégémonique de cette idéologie du progrès n’est pas nouveau selon Noble. Il remonterait au XIXe siècle et à la première révolution industrielle caractérisée par la mécanisation du travail qui, refrain connu, devait être vue comme un processus inéluctable auquel il fallait nécessairement s’adapter. Encore aujourd’hui, cette conception fataliste d’un déterminisme technologique faisant du progrès une réalité naturelle quasi darwinienne se retrouve dans des expressions abstraites comme « on n’arrête pas le progrès » et détourne notre attention des enjeux concrets d’exploitation. À cet égard, l’auteur ne s’en prend pas seulement aux stratégies capitalistes et aux groupes industriels qui en assurent le développement ; il critique également ceux qui, historiquement, devaient défendre les travailleurs mais qui, envoutés par le chant des sirènes du progrès technologique, finissaient par s’y soumettre.
La première révolution industrielle, qui a vu naître le mouvement ouvrier, a néanmoins donné lieu à des actes de résistance à ce « progrès ». L’auteur rappelle et réhabilite la lutte trop mal connue des luddites, ces tisserands anglais qui, au début du XIXe siècle, brisaient les nouvelles machines parce qu’ils refusaient d’être dépossédés de leur travail. Cependant, la deuxième révolution industrielle, que l’auteur associe à la vague d’informatisation d’après-guerre aux États-Unis, ne donna pas lieu à un tel mouvement de révolte – Noble allant même jusqu’à parler de paralysie collective devant cette nouvelle offensive technologique. Progressisme oblige, les représentants ouvriers devaient porter allégeance au sacro-saint progrès technologique amalgamé au progrès social, et ce, même s’il venait accentuer les rapports de domination, le « laisser-innover » devenant un autre visage du laisser-faire de l’économie de marché. Coupée de la concrétude et du présent de la réalité des travailleurs, la question technologique se retrouvait projetée dans une vision fantasmatique d’un monde à venir qui ouvrait peut-être des chantiers de recherche prometteurs pour les universitaires, mais abandonnait les travailleurs dans un état de subordination.
Qu’en est-il alors des solutions de rechange technologiques ? À cette question, l’auteur répondrait par une autre : peut-on créer de telles alternatives sans transformer à la base les rapports de pouvoir ? Car David Noble nous met en garde contre les fausses promesses qui « renforcent le fétichisme culturel pour la transcendance technologique » (p. 53). Comme le proclamaient les ouvriers de General Motors en Ohio lors de leur mobilisation, au début des années 1970, il importe de reconnaître d’abord que le progrès technologique est un processus politique et non un processus automatique et inévitable.
L’auteur ne condamne pas toute forme de technologie ; il nous invite plutôt au dépassement de l’attitude révérencieuse ainsi qu’au débat politique permettant l’élaboration de critères de discernement. Rappelant l’importance de ne pas confondre avenir et présent – car « on ne peut pas plus se permettre de délaisser l’avenir au profit de préoccupations immédiates, qu’on ne peut se concentrer sur l’avenir en abandonnant le présent » –, l’auteur conclut qu’il faut lier les deux et, dans cet esprit, « réévaluer les sciences et les technologies selon des critères liés à l’enrichissement de la vie » (p.89). Un rappel salutaire.